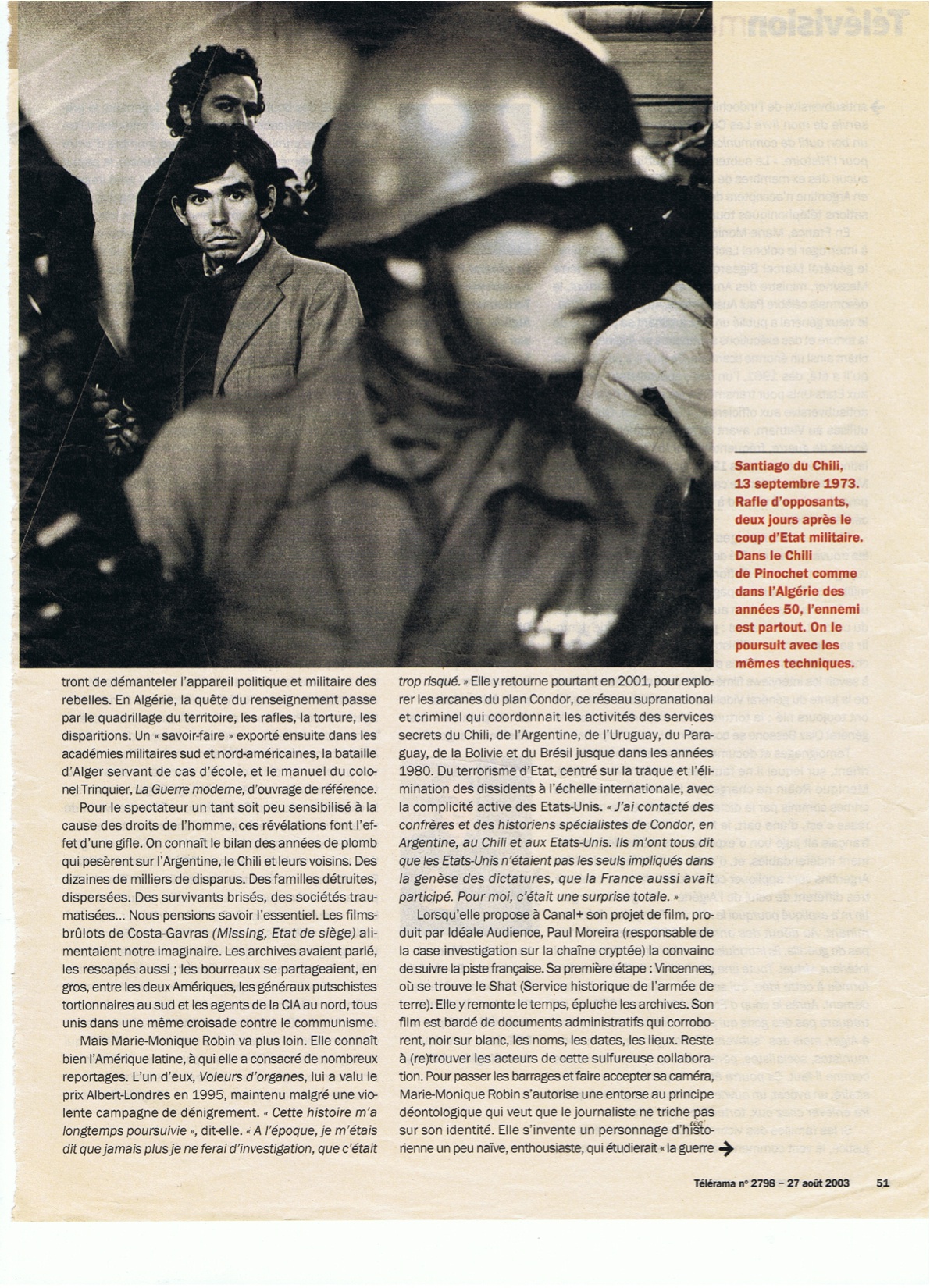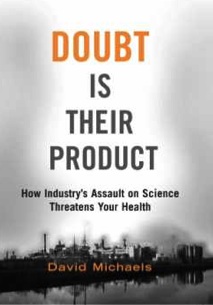Ca chauffe sur la toile et je m’en réjouis!
Les internautes auront remarqué le formidable retentissement qu’a provoqué la diffusion de mon film « Notre poison quotidien » mardi soir sur ARTE. Depuis, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont regardé le film sur ARTE + 7, et les commentaires vont bon train! La machine à désinformer s’est mise en marche, et on a vu Erik Orsenna déclarer que mon film était « malhonnête » ou Jean-François Narbonne, l’expert de l’ANSES qui roule pour l’Association française pour l’information scientifique (AFIS), un groupuscule dont j’ai déjà montré les liens avec Monsanto (voir mon Blog Le monde selon Monsanto) affirmer qu’il est plein de « contre-vérités« . A lire leurs commentaires, je ne suis pas sûre qu’ils aient eu le courage et l’honnêteté de voir mon film, tant leurs propos outranciers semblent télécommandés.
A dire vrai, la riposte ne m’étonne guère, car je savais que mon film et livre allaient gêner aux entournures, car le coeur de mon enquête montre que le système de réglementation des produits chimiques qui contaminent notre environnement protège davantage les produits chimiques que les consommateurs.
Il montre aussi que la Dose journalière acceptable » ou « admissible » (DJA), qui constitue le dogme de la vieille école de toxicologie incarné par Jean-François Narbonne et qui représente le fondement de la fameuse « réglementation » est approximatif et inopérant. C’est aussi ce que dit André Cicolella, un autre toxicologue, porte-parole du réseau Environnement Santé (RES):
http://television.telerama.fr/television/on-nous-fait-avaler-n-importe-quoi,66580.php
L’affaire de la DJA étant au coeur de la polémique, j’ai décidé de livrer ici, en exclusivité, le chapitre que je lui ai consacré dans mon livre que j’ai lancé aujourd’hui au salon du livre de la Porte de Versailles. J’y serai de nouveau demain pour une nouvelle séance de signatures sur le stand de La Découverte:
Chapitre 10: La formidable imposture scientifique de la « dose journalière acceptable » de poisons
« La science s’est transformée en administratrice d’une contamination mondiale de l’homme et de la nature. »
Ulrich Beck.
« Le système réglementaire qui est censé protéger la santé publique contre les effets des produits cancérigènes ne fonctionne pas. S’il était efficace, le taux d’incidence du cancer aurait dû diminuer, mais cela n’est pas le cas. Je pense que le principe de la dose journalière acceptable, qui représente l’outil principal de la réglementation des produits toxiques contaminant la chaîne alimentaire, protège davantage l’industrie que la santé des consommateurs. » Physicien, reconverti dans la philosophie et l’histoire des sciences, le Britannique Erik Millstone est professeur de « politique scientifique » (science policy), une chaire qui n’a pas d’équivalent dans le reste de l’Europe. Concrètement, il s’intéresse à la manière dont les autorités publiques établissent leur politique dans le domaine de la santé et de l’environnement et, tout particulièrement, au rôle joué par la science dans le processus décisionnel. Il m’a reçue un jour enneigé de janvier 2010 dans son bureau de l’université du Sussex, à Brighton dans le sud de l’Angleterre, au milieu de ses livres et documents soigneusement étiquetés d’après les recherches auxquelles il a consacré les trente dernières années de sa carrière : « Pollution au plomb », « Encéphalopathie spongiforme bovine », « Organismes génétiquement modifiés », « Pesticides », « Additifs alimentaires », « Aspartame », « Obésité », « Dose journalière acceptable ».
La « boîte noire » de l’invention de la « DJA »
Connu pour son franc-parler et son art de décortiquer les dossiers les plus complexes, Erik Millstone est l’un des meilleurs spécialistes européens du système de réglementation qui régit la sécurité des aliments, mais aussi l’un de ses critiques les plus redoutés. « Je vous mets au défi de trouver une quelconque étude scientifique qui justifie le principe de la dose journalière acceptable, car il n’y en a pas, m’a-t-il expliqué avec conviction. La sécurité des consommateurs repose sur l’utilisation d’un concept qui a été imaginé à la fin des années 1950 et est devenu un dogme intangible, alors qu’il est complètement dépassé et que personne ne peut en expliquer la légitimité scientifique[i]. »
De fait, j’ai passé des semaines à essayer de reconstituer la genèse de la « dose journalière acceptable » (ou « admissible ») – dans le jargon « DJA », traduction de l’anglais acceptable daily intake (ADI) –, notion utilisée pour fixer les normes d’exposition aux produits chimiques qui entrent en contact avec nos aliments : pesticides, additifs et plastiques alimentaires. Quand on fait une recherche sur le Web, on trouve certes une définition affirmant en substance : « La DJA est la quantité de substance chimique que l’on peut ingérer quotidiennement et pendant toute une vie sans qu’il n’y ait de risque pour la santé. » Mais cette définition ne s’accompagne d’aucune référence scientifique qui permette de comprendre comment le concept a été élaboré. Et quand on interroge ceux qui, chaque jour, se servent de cet outil pour déterminer, par exemple, quelle quantité de pesticide peut être tolérée dans notre alimentation, on obtient en général des réponses évasives et quelque peu embarrassées, comme par exemple celle d’Herman Fontier, le chef de l’Unité des pesticidesne de sécurité des aliments à l’Autorité européen, à qui j’ai posé la question quand je l’ai rencontré à Parme en janvier 2010 : « Cela fait vingt-trois ans que je m’occupe de l’autorisation des produits phytosanitaires et j’ai toujours connu le concept de la dose journalière acceptable, mais je dois avouer que je ne me suis jamais demandé comment avait été conçu cet instrument qui réglemente l’ingestion des substances chimiques. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a un consensus dans le monde scientifique qu’il y a lieu de fixer une DJA pour protéger les consommateurs[ii]. »
En écoutant la très courte explication de l’expert européen, j’ai repensé à mon enquête sur Monsanto, où j’avais de la même manière essayé de remonter à l’origine du « principe d’équivalence en substance », qui faisait lui aussi consensus pour la réglementation des OGM. J’avais découvert que ce concept – consacré en 1992 par la FDA –, qui affirme qu’une plante transgénique est « similaire en substance » à la plante conventionnelle dont elle est issue, ne reposait sur aucune donnée scientifique : elle découlait d’une décision politique, fortement téléguidée par les intérêts commerciaux du leader mondial des biotechnologies. Pourtant, ce principe s’est imposé depuis auprès des agences de réglementation internationales, au point qu’elles continuent de l’invoquer pour justifier l’absence d’évaluation scientifique sérieuse des plantes transgéniques mises sur le marché.
Tout indique qu’il en est de même pour la « dose journalière acceptable », qui ressemble fort à ce que le sociologue et philosophe des sciences Bruno Latour appelle une « boîte noire », pour désigner l’oubli des modalités de reconnaissance des acquis scientifiques ou techniques admis ensuite comme des évidences, le plus souvent après de vives controverses. Dans son passionnant ouvrage La Science en action[iii], celui-ci explique comment une découverte originale – comme la double hélice de l’ADN ou l’ordinateur Eclipse M V/8000 –, fruit d’un long processus de recherche expérimentale et théorique, devient un « objet stable froid » ou un « fait établi », dont plus personne – y compris les scientifiques qui s’en servent comme d’un outil – n’est en mesure de comprendre les « rouages internes » ni de « défaire les liens innombrables » qui ont présidé à sa création. De manière similaire, le principe de la dose journalière acceptable, auquel les toxicologues et les gestionnaires du risque chimique font sans cesse référence, est devenu une « connaissance tacite profondément encapsulée » dans la « pratique silencieuse de la science », qui « aurait pu être connue depuis des siècles ou donnée par Dieu dans les Dix commandements », tant son histoire se perd dans la nuit des temps.
« Le problème, a souligné Erik Millstone, c’est que la DJA est une boîte noire très différente de celles que Bruno Latour prend pour exemples. En effet, si la double hélice de l’ADN est une réalité scientifique établie sur laquelle se sont appuyés d’autres chercheurs pour faire progresser la connaissance, par exemple, sur le génome humain, il est toujours possible, pour qui en a la capacité et le temps, de reconstituer les multiples étapes qui ont conduit James Watson et Francis Crick à faire cette découverte. Mais pour la DJA, il n’y a rien de semblable, car elle est le résultat d’une décision arbitraire érigée en concept pseudoscientifique pour couvrir les industriels et protéger les politiciens qui ont besoin de se cacher derrière des experts pour justifier leur action. La dose journalière acceptable est un artefact indispensable pour ceux qui ont décidé qu’on avait le droit d’utiliser des produits chimiques toxiques, y compris dans le processus de la production agroalimentaire.
– Et on ne sait vraiment pas qui a inventé ce concept ?, ai-je insisté.
– D’après l’Organisation mondiale de la santé, la paternité en revient à un toxicologue français du nom de René Truhaut, m’a répondu Erik Millstone, même si aux États-Unis on préfère l’attribuer à Arnold Lehman et Garth Fitzhugh, deux toxicologues de la Food and Drug Administration qui travaillèrent sur des questions similaires. »
Le précurseur René Truhaut, toxicologue français adepte de Paracelse
Têtue comme un mulet de mon Poitou natal, je me suis donc rendue à Genève pour consulter les archives de l’OMS. Et dans le répertoire thématique de l’imposant centre de documentation, j’ai effectivement trouvé plusieurs références à René Truhaut (1909-1994), qui fut titulaire de la chaire de toxicologie de la faculté de Paris et est considéré comme l’un des pionniers de la cancérologie française. Auteur d’une thèse de doctorat en pharmacie, intitulée Contribution à l’étude des cancérigènes endogènes, ce « travailleur infatigable et acharné » est devenu un spécialiste de la toxicologie alimentaire qui tenta « d’élucider le devenir d’un grand nombre de substances chimiques dans l’organisme et d’en interpréter le mécanisme d’action », pour reprendre les termes de l’académicien belge Léopold Molle dans l’hommage qu’il lui rendit en 1984[iv]. « Précurseur de la toxicocinétique[1] », le professeur Truhaut a dirigé le laboratoire de toxicologie de la faculté de pharmacie de Paris, où il s’est consacré à « l’évaluation des potentialités toxiques, y compris la potentialité cancérigène, d’agents chimiques susceptibles d’être incorporés, volontairement ou involontairement, dans les aliments, comme les résidus de pesticides et d’anabolisants, les agents conservateurs et émulsifiants, les colorants naturels et synthétiques ».
J’ai pu visionner l’une des rares interviews accordées par René Truhaut, dans le cadre d’un documentaire réalisé en 1964 par Jean Lallier (1928-2005). Intitulé Le Pain et le Vin de l’an 2000, ce film posait déjà toutes les (bonnes) questions auxquelles j’essaie de répondre dans ce livre, près de cinquante ans plus tard. Il s’interrogeait notamment sur l’efficacité de la réglementation alors balbutiante des produits chimiques qui contaminent la chaîne alimentaire et sur le rôle joué par les toxicologues dans ce processus. Sur les images, on voit René Truhaut en blouse blanche, installé dans son laboratoire de la faculté de pharmacie. « Si vous me permettez de faire une comparaison, expliquait-il avec un souci pédagogique évident, au siècle dernier, lorsque ce citoyen du monde que fut Pasteur a découvert le danger des bactéries, eh bien dans le domaine alimentaire spécifiquement, on a accordé une très grande importance au contrôle microbiologique des aliments et on a fondé toute une série de laboratoires pour effectuer ce contrôle. Eh bien, il faudrait qu’il en soit de même dans le cadre du contrôle des agents chimiques ajoutés aux aliments, parce que leurs dangers, pour être plus insidieux, moins spectaculaires, si vous voulez, n’en sont à mon avis certainement pas moins graves[v]. »
Membre des académies françaises de médecine et des sciences, René Truhaut avait son entrée dans toutes les grandes instances internationales, ainsi que le révèle son impressionnant curriculum vitae : il fut membre de la Commission internationale permanente des maladies professionnelles, du Bureau international du travail, de l’Union internationale contre le cancer, de l’Union internationale de chimie pure et appliquée, ainsi que de nombreux comités scientifiques des Communautés européennes, dont le Comité sur l’écotoxicité et la toxicité des produits chimiques, qu’il présida. Mais son nom est surtout associé à l’OMS, qu’il fréquenta assidûment pendant plus de trente ans. C’est dans le cadre de l’institution onusienne qu’il développa le principe de la DJA, ainsi qu’il l’a revendiqué dans un article publié en 1991 : « Je crois avoir vraiment été l’initiateur du concept de la dose journalière acceptable (DJA), comme cela a d’ailleurs été reconnu dans plusieurs articles écrits par des experts qui ont vécu avec moi, pendant la période des années 1950 à 1962, écrit-il alors avec une certaine retenue dont on ne sait si c’est de la prudence ou de la modestie. Malheureusement et paradoxalement, je n’ai, à l’époque, rien publié dans des périodiques scientifiques[vi]. »
C’est effectivement fort dommage, car on n’en saura pas plus sur la genèse scientifique du fameux principe qui, à lire le toxicologue français, ne semble pas découler d’un modèle expérimental dûment éprouvé, mais plutôt d’une idée théorique, certes lumineuse et généreuse, qu’il développa au fil de ses recherches : « Engagé depuis le début de ma carrière dans l’évaluation toxicologique des agents chimiques à l’absorption prolongée desquels l’homme est exposé dans différents domaines, j’ai toujours considéré comme une règle d’or le principe émis par Paracelse il y a maintenant cinq siècles : “Sola dosis facit venenum” (c’est seulement la dose qui fait le poison), explique-t-il. Cela m’a conduit à accorder une importance primordiale à l’établissement de doses-effets dans la méthodologie d’évaluation toxicologique, de manière à pouvoir fixer des limites admissibles. »
On se souvient du rôle qu’avait joué le « père de la toxicologie » dans les travaux conduits par Robert Kehoe sur la toxicité du plomb (voir supra, chapitre 8). Le directeur du Laboratoire Kettering, qui travaillait à la solde des industriels, avait autopsié les cadavres de nouveaux nés, victimes d’une intoxication au plomb, et mené des expériences sur des « volontaires » pour déterminer une dose d’exposition qui lui paraisse sans danger et ainsi contrer les attaques des opposants à l’essence au plomb. Kehoe avait réussi à imposer une théorie fondée sur quatre principes et qui ressemble étrangement au concept de la DJA : « 1) l’absorption du plomb est naturelle ; 2) le corps dispose de mécanismes permettant de l’assimiler ; 3) au-dessous d’un certain seuil, le plomb est inoffensif ; 4) l’exposition du public est bien inférieure à ce seuil et n’est donc pas préoccupante. »
1961 : l’officialisation « scientifique » du principe « un peu flou » de la DJA
Il y a fort à parier que René Truhaut connaissait les travaux du toxicologue attitré des fabricants de poison, car, comme lui, il s’intéressait aux effets des polluants professionnels : c’est lui qui promut les « limites admissibles des toxiques dans les atmosphères de travail et/ou dans les milieux biologiques des sujets exposés », auprès de la Commission internationale permanente des maladies professionnelles qui se réunit à Helsinki en 1957. Ses recherches dans le domaine de la santé au travail lui valurent en 1980 le « Yant Havard » de l’Association américaine de l’hygiène industrielle, dont Robert Kehoe fut le président.
Mais dans les documents que j’ai retrouvés à l’OMS, l’« initiateur du concept de la DJA », comme il se présente lui-même, ne dit rien sur les travaux qui ont inspiré son invention ni sur les études qu’il aurait pu réaliser pour la nourrir. Il se contente de dresser une chronologie des événements qui ont conduit l’OMS et la Food and Agriculture Organization (FAO) à adopter sa proposition. On découvre ainsi, dans un texte qu’il a rédigé en 1981, qu’en « 1953, la sixième assemblée mondiale de la santé [l’organe qui détermine la politique de l’OMS] a exprimé l’avis que l’utilisation croissante de multiples substances chimiques par l’industrie alimentaire au cours des dernières décennies avait créé un nouveau problème de santé publique qu’il était nécessaire d’étudier[vii] ». De son côté, la FAO notait « le manque sérieux de données concernant de nombreux additifs alimentaires tant sur leur pureté que sur les dangers sanitaires que peut impliquer leur usage ».
C’est ainsi qu’en septembre 1955, les deux organisations de l’ONU décidèrent de créer un comité d’experts chargé d’« étudier les multiples facettes des problèmes liés à l’utilisation d’additifs alimentaires afin de fournir des lignes directives ou des recommandations aux autorités de santé publique et aux autres agences gouvernementales des différents pays du monde ». La préoccupation première de cette conférence fondatrice ne concerne donc que les « additifs alimentaires », qu’elle définit alors comme des « substances non nutritives ajoutées intentionnellement à la nourriture dans de faibles quantités, pour améliorer son apparence, sa saveur, sa texture ou ses facultés de conservation ». L’initiative conduira à la création du Joint FAO/WHO Expert Meeting Committee on Food Additives (JECFA), dont la première session s’est tenue à Rome, en décembre 1956. Nommés par la FAO et l’OMS, les experts, dont faisait partie René Truhaut, adoptèrent le principe dit des « listes positives », selon lequel « l’emploi de toute substance, non autorisée sur des bases toxicologiques adéquates, est interdit[viii] ». Concrètement, cette recommandation signifie qu’aucun nouvel additif alimentaire ne peut être utilisé par l’industrie agroalimentaire sans avoir subi au préalable des tests toxicologiques qui doivent être soumis pour évaluation au JECFA (ou à une agence nationale). Sur le fond, c’était une avancée spectaculaire, allant clairement dans le sens de la protection des consommateurs. Mais nous verrons avec l’exemple de l’aspartame (voir infra, chapitres 14 et 15) comment ce système d’évaluation sera régulièrement détourné par l’industrie à son seul et unique profit.
Les experts soulignaient aussi la nécessité d’accorder une « importance primordiale à l’utilité technologique de l’additif soumis à l’évaluation toxicologique[ix] ». Cette remarque est intéressante, car elle permet de comprendre le contexte idéologique dans lequel s’inscrivait la démarche de René Truhaut et de ses collègues. À aucun moment, ils ne questionnent la nécessité sociale d’utiliser des substances chimiques pour la production d’aliments, même si celles-ci sont a priori toxiques, ainsi qu’il l’a lui-même reconnu dans la deuxième interview télévisée que j’ai pu consulter : « Un consommateur qui absorbe par exemple une petite quantité de colorant pendant deux semaines, pendant deux mois, pendant un ou deux ans, peut n’avoir aucun effet nocif, déclarait-il ainsi de sa voix haut perchée. Mais il faut prévoir que ces petites doses longtemps répétées, jour après jour, pendant toute une vie, peuvent parfois comporter des risques extrêmement insidieux et même parfois des risques irréversibles, car il y a certains colorants, par exemple, qui au moins chez l’animal se sont avérés capables de provoquer des proliférations malignes, c’est-à-dire des cancers[x]. »
À l’évidence sincèrement soucieux des risques pour la santé publique liés à la présence d’adjuvants chimiques dans les aliments, René Truhaut exprime ainsi une préoccupation, pas si fréquente à l’époque, sur les « risques du progrès ». Pour autant, il n’entend aucunement remettre en cause l’idée que ces innovations auraient une « utilité technologique » : il ne s’agit pas pour lui de demander l’interdiction pure et simple de substances cancérigènes « ajoutées intentionnellement à la nourriture » dans le seul intérêt économique des fabricants, mais de gérer au mieux le risque qu’elles engendrent pour le consommateur, en essayant de le réduire au minimum. C’est ainsi que lors de la deuxième session du JECFA, qui s’est tenue à Genève en juin 1957, les experts ont longuement disserté sur le type d’études toxicologiques qu’il fallait exiger des industriels pour déterminer la dose de poison qu’on pouvait tolérer dans les aliments. Je dis bien « poison », car si la substance concernée n’était pas suspectée d’en être un, le JECFA n’aurait aucune raison d’exister, ni d’ailleurs la fameuse DJA.
Pour bien comprendre le caractère pour le moins approximatif de la démarche, il faut citer le récit qu’en a fait postérieurement René Truhaut, en 1991 : « J’ai contribué à introduire, dans le rapport final un nouveau chapitre “Évaluation des concentrations probablement inoffensives pour l’homme” avec les phrases suivantes : “En s’appuyant sur ces diverses études, on peut fixer dans chaque cas la dose maximale qui ne provoque, chez les animaux employés, aucun effet décelable (ci-après appelés pour plus de brièveté “dose maximum sans effet décelable”, en anglais, maximum ineffective dose). Lorsqu’on extrapole cette dose à l’homme, il est opportun de prévoir une certaine marge de sécurité”. » Et d’ajouter, avec une étonnante franchise : « C’était un peu flou[xi]. »
C’est effectivement le moins que l’on puisse dire, mais cela n’empêcha pas le JECFA d’adopter le principe de la dose journalière acceptable lors de sa sixième session de juin 1961, où les experts décidèrent d’exprimer la « dose ne provoquant, dans l’expérimentation, aucun effet ayant une signification toxicologique en mg/kg de poids corporel/jour ». Avant d’expliquer plus en détail ce que signifie précisément cette unité de mesure cabalistique, il convient de souligner, une fois de plus, la lucidité du « père de la DJA », qui avoue dans un même élan les limites de sa création : « Lorsqu’on parle de doses sans effet dans l’expérimentation toxicologique, il faut savoir que seule la dose zéro doit être ainsi considérée, toute autre dose comportant un effet, si minime soit-il[xii]. » En d’autres termes : la DJA n’est pas la panacée, mais elle permet de limiter les dégâts que causeront immanquablement les substances chimiques ingérées, comme les additifs alimentaires, mais aussi les résidus de pesticides.
En effet, en 1959, alors qu’ont lieu les premières sessions du JECFA, la FAO propose la création d’un comité similaire, chargé d’étudier les « dangers posés aux consommateurs par les résidus de pesticides que l’on trouve sur et dans les aliments et fourrages[xiii] ». Cette nouvelle initiative est la preuve, s’il en était besoin, qu’avant cette date personne ne s’était sérieusement préoccupé des effets que pouvaient avoir les pesticides sur la santé humaine, alors que les poisons agricoles avaient déjà largement conquis les champs des paysans. Trois ans plus tard, au moment où Le Printemps silencieux de Rachel Carson défraye la chronique internationale, la FAO réunit une conférence pour « formuler et recommander un programme d’action future concernant les aspects scientifiques, législatifs et réglementaires de l’usage des pesticides dans l’agriculture », ainsi que le rapportera en 1981 René Truhaut, qui fut l’un des principaux protagonistes de ces rencontres[xiv].
Il raconte notamment qu’il a participé à un groupe de travail « sur la lutte contre la mouche de l’olive, culture fort importante, comme chacun sait, dans le bassin méditerranéen ». Et de préciser : « J’ai été confronté au problème de la fixation, dans l’huile d’olive livrée à la consommation humaine, de limites maximales de résidus de divers insecticides organophosphorés et notamment du parathion[2]. La limite de concentration généralement adoptée dans les divers pays du monde était alors de 1 mg/kg d’huile. Mais, sur le plan toxicologique, tout dépend de la quantité d’huile consommée par jour. Le pâtre grec qui a des olives à sa disposition plonge son pain dans l’huile et peut en absorber jusqu’à 60 g par jour. Il absorbe donc beaucoup plus de parathion que des consommateurs qui n’ingèrent de l’huile d’olive qu’avec la salade. Et, raisonnant sur cet exemple, j’ai été conforté dans mon idée qu’il fallait inverser le problème et fixer une dose à partir de laquelle on pourrait calculer les tolérances à fixer pour tel ou tel aliment en fonction de la quantité moyenne consommée dans telle ou telle région[xv]. » Ce que décrivait là le toxicologue français en 1991 correspond exactement à la tâche assignée au Joint FAO/WHO Meeting on Pesticides Residues (JMPR), le comité d’experts institué par l’OMS et la FAO en octobre 1963, pour établir la DJA des pesticides, mais aussi ce que l’on appelle les « limites maximales de résidus » (LMR), à savoir la quantité de résidus de pesticides autorisée sur chaque produit agricole traité (voir chapitre suivant).
Le lobby des industriels, actif promoteur de la DJA
« L’application du concept ainsi défini a rendu de grands services aux autorités chargées de l’établissement des régulations dans le domaine agroalimentaire et a, d’autre part, grandement facilité le commerce international[xvi] », conclut sobrement René Truhaut dans son article rétrospectif – lequel était en fait la retranscription d’une allocution donnée dans le cadre d’un atelier intitulé « Le concept de la DJA, un instrument pour assurer la sécurité des aliments », organisé en octobre 1990 en Belgique par l’International Life Sciences Institute (ILSI)[xvii].
C’est intéressant, car l’ILSI est de longue date un actif promoteur de la notion de dose journalière acceptable, en la promouvant à grand renfort de colloques et de publications. Or, cet « institut » est loin d’être neutre, puisqu’il a été fondé à Washington en 1978 par de grandes firmes de l’agroalimentaire (Coca-Cola, Heinz, Kraft, General Foods, Procter & Gamble), auxquelles se sont jointes ensuite bien d’autres firmes leaders de ce secteur (Danone, Mars, McDonald, Kellog ou Ajinomoto, le principal fabricant d’aspartame), mais aussi sur le marché des pesticides (comme Monsanto, Dow AgroSciences, DuPont de Nemours, BASF) ou sur celui des médicaments (Pfizer, Novartis)[3]. À l’exception de l’industrie pharmaceutique, toutes ces entreprises ont prospéré grâce à l’avènement des révolutions verte et agroalimentaire : elles fabriquent ou utilisent des produits chimiques qui contaminent nos aliments.
Sur son site Web[xviii], l’ILSI Europe, qui se présente comme une « organisation à but non lucratif », affirme que sa « mission » est de « faire avancer la compréhension des sujets scientifiques liés à la nutrition, la sécurité des aliments, la toxicologie, l’évaluation des risques et l’environnement » ; et qu’« en mettant en relation des scientifiques issus de l’université, des gouvernements, de l’industrie et du secteur public », il « vise une approche équilibrée permettant de résoudre des préoccupations communes pour le bien-être du public général ». Mais derrière ces bonnes intentions affichées, se cache une réalité beaucoup plus prosaïque.
Jusqu’en 2006, en effet, l’ILSI disposait d’un statut exceptionnel auprès de l’OMS, car ses représentants pouvaient participer directement aux groupes de travail visant à établir les normes sanitaires internationales. L’institution onusienne lui a retiré ce privilège après qu’ont été révélées les pratiques de lobbying de l’organisme industriel qui, sous couvert d’une pseudo-indépendance, promouvait les intérêts de ses membres[xix]. C’est ainsi qu’on découvrit qu’il avait financé un rapport sur les hydrates de carbone (glucides), publié par l’OMS et la FAO, qui concluait à l’absence de lien direct entre la surconsommation de sucre et l’obésité ou toute autre maladie chronique[xx]. De même, en 2001, un rapport interne de l’OMS dénonçait les « liens politiques et financiers » de l’ILSI avec l’industrie du tabac[xxi], pour laquelle l’institut avait financé un certain nombre d’études minimisant l’impact sanitaire du tabagisme passif, au moment où le CIRC envisageait de le classer comme cancérigène pour les humains. Ces révélations étaient fondées sur sept cents documents déclassifiés issus des cigarettes papers (voir supra, chapitre 8), qui attestaient seize ans de collaboration intense entre 1983 et 1998[xxii].
Et en 2006, l’Environmental Working Group de Washington a révélé que l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) avait fondé ses normes d’exposition aux hydrocarbures perfluorés (PFC, pour perfluoro-carbon) – entrant notamment dans la composition du Téflon, que l’on retrouve par exemple dans les poêles antiadhésives – sur un rapport fourni par l’ILSI[xxiii]. Ce dernier concluait que les cancers induits chez des rats par ces substances hautement toxiques n’étaient pas extrapolables aux humains et qu’on pouvait donc considérer le produit comme inoffensif. Finalement, l’EPA portera plainte en juillet 2004 contre DuPont, membre de l’ILSI et principal fabricant de Téflon, qui sera condamné en décembre 2006 à une amende de 16,6 millions de dollars pour avoir caché, pendant plus de vingt ans, des études expérimentales montrant que l’exposition aux PFC provoquait « des cancers du foie et des testicules, une réduction du poids à la naissance et une suppression du système immunitaire[xxiv] ».
Comme le soulignait en 2005 le biologiste américain Michael Jacobson, cofondateur en 1971 du Center for Science in the Public Interest, l’ILSI se vante de vouloir « œuvrer pour un monde plus sûr et plus sain, mais la question est de savoir : à qui cela profite-t-il véritablement[xxv] ? ». Ce qui est sûr, c’est que l’institut dispose de moyens financiers importants, lui permettant de « financer des conférences et d’envoyer des scientifiques aux réunions gouvernementales pour représenter les intérêts de l’industrie sur des sujets controversés ». Parmi eux : la dose journalière acceptable, à laquelle l’ILSI a consacré une « monographie » entière en 2000, preuve que la création de René Truhaut lui tient particulièrement à cœur.
Diane Benford : « Pourquoi nous avons besoin de la DJA »
Intitulé « La dose journalière acceptable, un outil pour assurer la sécurité des aliments »[xxvi] – ce qui était aussi le titre de l’atelier (workshop) auquel avait participé René Truhaut dix ans plus tôt –, le document constitue une pièce rare, car, on l’a vu, la DJA est une « boîte noire » créée ex nihilo pour laquelle on peine à trouver des études de référence. Le texte a été rédigé, à la demande de l’ILSI, par Diane Benford, qui dirige le département du risque chimique à la Food Standards Agency, l’agence chargée des normes alimentaires au Royaume-Uni. Il est instructif de noter que pour vanter les mérites de l’outil favori des toxicologues et industriels, l’ILSI a fait appel à une représentante de l’autorité publique, dont la mission est de veiller à la santé des consommateurs. Et je dois avouer qu’il ne fut pas simple d’obtenir un rendez-vous avec la toxicologue britannique, dont je soupçonne qu’elle m’avait « googlelisée » et craignait sans doute quelques questions dérangeantes. Pourtant, j’avais été autorisée à me recommander d’Angelika Tritscher, la secrétaire du JECFA et du JMPR à l’OMS (que nous rencontrerons bientôt), qui m’avait indiqué l’existence de la monographie de l’ILSI, un organisme dont elle fréquente régulièrement les instances. Finalement, après moult échanges de courriels, Diane Benford a accepté de me rencontrer, à condition que je lui envoie au préalable les questions que j’entendais lui poser. En fait, ce n’était pas vraiment un problème, puisque j’avais justement l’intention de lui demander de m’expliquer comment était calculée concrètement la dose journalière acceptable, une activité dont elle était l’une des spécialistes patentées.
Pendant mon voyage dans l’Eurostar qui me conduisait à Londres, j’avais soigneusement épluché son texte qui commence par cette introduction : « Le concept de la DJA est accepté internationalement comme la base de l’estimation de la sécurité des additifs alimentaires et des pesticides ainsi que de l’évaluation des polluants, et donc de la réglementation dans le domaine de la nourriture et de l’eau potable. Les préoccupations du public pour la sécurité des aliments ont conduit à une exigence de plus grande transparence concernant les évaluations des experts qui sont en lien avec la santé humaine. […] La compréhension du concept de la DJA ne peut qu’améliorer la transparence et la confiance dans les évaluations réalisées[xxvii]. »
Dans ce genre de document, où chaque mot a été pesé, il faut savoir lire entre les lignes et, ici, tout indique que la commande de l’ILSI répond à un souci de ses membres de désamorcer les critiques récurrentes par rapport à l’opacité du système de réglementation des poisons dont la DJA est le pilier. Ces critiques ne sont pas nouvelles, ainsi que le prouve cet aveu surprenant de René Truhaut rédigé à la première personne du pluriel : « Nous sommes parfaitement conscients que, en raison de la multiplicité et de la complexité des problèmes, l’approche retenue est loin d’être parfaite, écrivait-il dans un document de 1973 que j’ai retrouvé dans les archives de l’OMS. C’est pourquoi nous comprenons et parfois nous partageons les critiques exprimées contre la doctrine appliquée jusqu’à présent par les comités d’experts de la FAO et de l’OMS. Le corollaire, c’est de savoir garder un esprit ouvert à toute nouvelle connaissance qui permette de corriger ou d’améliorer la méthodologie de l’évaluation toxicologique. La recherche dans ce domaine typiquement pluridisciplinaire doit être encouragée et financée[xxviii]. »
Pour être franche, cette « confession » du toxicologue français m’a définitivement réconciliée avec lui, car il m’est soudainement apparu comme un homme de bonne foi, désireux d’éviter le désastre sanitaire annoncé et incapable d’imaginer à quel point l’embryon de système qu’il avait contribué à mettre en place allait être détourné par les industriels, dont le seul objectif fut précisément d’empêcher que celui-ci soit « corrigé » ou « amélioré » au profit des consommateurs (ce qui était sans aucun doute le souhait de Truhaut). Donc, si l’ILSI a demandé à Diane Benford de rédiger une monographie sur la DJA, c’est parce que ses très généreux financeurs craignent que la valeureuse « doctrine », qui a si bien servi leurs intérêts, finisse par pâtir des critiques concernant le manque de transparence du système qu’elle incarne.
Après son introduction, la toxicologue britannique reprend les poncifs de l’industrie dans une première partie intitulée « Pourquoi nous avons besoin de la DJA », où le « nous » désigne les consommateurs, à qui la « monographie » est manifestement destinée : « Tout au long du xxe siècle, on a constaté une tendance croissante à utiliser des aliments transformés et stockés. Initialement, c’était la réponse à l’industrialisation et au besoin de fournir de la nourriture à la population nombreuse vivant dans les villes. […] Les processus de production et de stockage des aliments exigent généralement l’addition de produits chimiques (naturels ou fabriqués par l’homme) pour améliorer la sécurité (microbiologique) ou pour préserver la qualité nutritionnelle. Un bénéfice supplémentaire est une saveur accrue et une meilleure apparence des aliments pour le consommateur. Il est évident que la sécurité de ces produits chimiques doit être garantie et leur usage contrôlé pour éviter des effets nocifs. » Après ce morceau d’anthologie, Diane Benford rappelle le rôle de René Truhaut, le « père de la DJA », puis cite l’incontournable Paracelse : « Rien n’est poison, tout est poison : seule la dose fait le poison. »
Études falsifiées et « bonnes pratiques de laboratoire »
« Le concept qui constitue la base de la DJA, c’est le principe de Paracelse : “Seule la dose fait le poison.” Qu’est ce que cela veut dire exactement ?, ai-je demandé à la responsable de l’agence britannique des normes sanitaires.
– Cela signifie que la probabilité d’avoir des effets toxiques augmente avec la dose, m’a-t-elle répondu, avec un air crispé dont elle ne s’est pas départie tout au long de l’entretien. Mais fondamentalement, c’est vrai pour tout, y compris pour l’eau ou l’oxygène, sans lesquels nous ne pouvons pas vivre : si nous en absorbons en trop grandes quantités, cela peut être aussi nocif.
– Certes, dis-je, un peu surprise par la comparaison. Mais entre l’eau et un pesticide conçu pour tuer, il y a tout de même une différence, n’est-ce pas ?
– Oui… Mais, d’une manière générale, avec la plupart des éléments, plus la dose est faible, plus la probabilité d’avoir des effets négatifs diminue…
– C’est ce que les toxicologues appellent la “relation dose-effet” ?
– C’est cela… Non seulement la gravité de l’effet augmente avec la dose, mais aussi le nombre d’individus qui ont une réaction négative…
– Si je comprends bien, tout le processus d’évaluation part du principe que les substances chimiques sont toxiques et on essaie de trouver une dose qui est censée ne produire aucun effet ?
– Oui, a lâché la toxicologue britannique après un long silence. Les études toxicologiques recherchent toute une série d’effets qu’un produit chimique peut provoquer en essayant de trouver une dose qui ne cause aucun de ces effets…
– C’est un système très compliqué, n’est ce pas ?
– Ah oui ! Il y a beaucoup de choses à évaluer et nous faisons du mieux que nous pouvons pour protéger les consommateurs…
– Et qui conduit les études toxicologiques ?
– C’est l’industrie. Ces études sont très chères et ce serait une charge considérable pour les contribuables si elles devaient être financées par des fonds publics. Bien sûr, comme c’est l’intérêt des industriels d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché de leur produit, on peut se demander s’ils conduisent les tests de manière adéquate. C’est pourquoi on a développé des lignes directives qui définissent les protocoles expérimentaux, avec des indications précises sur le profil des chercheurs, qui doivent être formés, ou sur la manière dont les données brutes doivent être enregistrées, pour pouvoir, au besoin, réaliser des contrôles sur la validité des résultats.
– C’est ce qu’on appelle les “bonnes pratiques de laboratoire” ?
– Oui…
– Le règlement des “bonnes pratiques de laboratoire” a été conçu par l’OCDE après plusieurs scandales qui ont révélé que de grands laboratoires américains travaillant pour l’industrie trichaient et manipulaient le résultat de leurs études, n’est-ce pas ?
– Oui, c’est pour cela qu’il y a maintenant ce règlement qui permet d’effectuer des inspections dans les laboratoires privés pour vérifier qu’ils travaillent correctement[xxix]… »
Dans mon livre Le Monde selon Monsanto, je racontais, en effet, qu’à la fin des années 1980, un procès avait défrayé la chronique : il concernait les Industrial Bio-Test Labs (IBT) de Northbrook, un laboratoire privé dont l’un des dirigeants était Paul Wright, un toxicologue venu de Monsanto, recruté au début des années 1970 pour superviser les études sur les effets sanitaires du PCB, mais aussi d’un certain nombre de pesticides. En fouillant dans les archives du laboratoire, les inspecteurs de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) avaient découvert que des dizaines d’études présentaient de « sérieuses déficiences et incorrections » et une « falsification routinière des données » destinée à cacher un « nombre infini de morts chez les rats et souris » testés[xxx]. Parmi les études incriminées se trouvaient trente tests conduits sur le glyphosate (la matière active du Roundup)[xxxi]. « Il est difficile de ne pas douter de l’intégrité scientifique de l’étude, notait ainsi un toxicologue de l’EPA, notamment quand les chercheurs d’IBT expliquent qu’ils ont conduit un examen histologique des utérus prélevés sur des… lapins mâles[xxxii]. »
En 1991, les laboratoires Craven étaient à leur tour accusés d’avoir falsifié des études censées évaluer les effets de résidus de pesticides, dont le Roundup, présents sur des fruits et légumes, ainsi que dans l’eau et les sols[xxxiii]. « L’EPA a expliqué que ces études étaient importantes pour déterminer les niveaux de pesticide autorisés dans les aliments frais ou transformés, écrivait le New York Times. Le résultat de la manipulation, c’est que l’EPA a déclaré sains des pesticides dont il n’a jamais été prouvé qu’ils l’étaient véritablement[xxxiv]. » La fraude généralisée a valu au propriétaire des laboratoires une condamnation à cinq ans de prison, alors que Monsanto et les autres compagnies chimiques, qui avaient profité des études complaisantes, ne furent jamais inquiétées…
(suite: demain!)
[1] La toxicocinétique étudie le devenir des médicaments et des substances chimiques dans l’organisme en analysant les mécanismes de résorption, distribution, métabolisme et excrétion.
[2] Le parathion a été interdit en Europe en 2003, en raison de sa haute toxicité. Il fait partie des insecticides qui ont rejoint la liste de la « sale douzaine » des polluants persistants, à bannir à tout prix. Jusqu’à son interdiction, il avait une DJA de 0,004 mg par kg de poids corporel…
[3] On peut consulter la liste complète des soixante-huit membres financeurs de la branche européenne de l’ILSI, créée en 1986, sur le site d’ILSI Europe, <www.ilsi.org/Europe>. Siégeant à Washington, l’ILSI est implanté sur tous les continents.
Notes du chapitre 12
[i] Entretien de l’auteure avec Erik Millstone, Brighton, 12 janvier 2010.
[ii] Entretien de l’auteure avec Herman Fontier, Parme, 19 janvier 2010. C’est moi qui souligne.
[iii] Bruno Latour, La Science en action. Introduction à la sociologie des sciences, La Découverte, Paris, 1989. Toutes les citations qui suivent sont extraites des pages 59, 64 et 107.
[iv] Léopold Molle, « Éloge du professeur René Truhaut », Revue d’histoire de la pharmacie, vol. 72, n° 262, 1984, p. 340-348.
[v] Jean Lallier, Le Pain et le Vin de l’an 2000, documentaire diffusé sur l’ORTF le 17 décembre 1964. Ce film fait partie des bonus du DVD de mon film Notre poison quotidien.
[vi] René Truhaut, « Le concept de la dose journalière acceptable », Microbiologie et Hygiène alimentaire, vol. 3, n° 6, février 1991, p. 13-20.
[vii] René Truhaut, « 25 years of JECFA achievements », Rapport présenté à la 25e session du JECFA, 23 mars-1er avril 1981, OMS Genève (archives de l’Organisation mondiale de la santé).
[viii] René Truhaut, « Le concept de la dose journalière acceptable », loc. cit.
[ix] Ibid.
[x] Interview diffusée dans le journal télévisé de l’ORTF le 3 juin 1974.
[xi] René Truhaut, « Le concept de la dose journalière acceptable », loc. cit. C’est moi qui souligne.
[xii] Ibid. C’est moi qui souligne.
[xiii] René Truhaut, « 25 years of JECFA achievements », loc. cit.
[xiv] Ibid.
[xv] René Truhaut, « Le concept de la dose journalière acceptable », loc. cit.
[xvi] Ibid.
[xvii] « The ADI concept. A tool for insuring food safety », lLSI Workshop, Limelette, Belgique, 18-19 octobre 1990.
[xviii] <www.ilsi.org/Europe>.
[xix] « WHO shuts Life Sciences Industry Group out of setting health standards », Environmental News Service, 2 février 2006.
[xx] WHO/FAO, « Carbohydrates in human nutrition », FAO Food and nutrition paper, n° 66, 1998, Rome.
[xxi] Tobacco Free Initiative, « The tobacco industry and scientific groups. ILSI : a case study », <www.who.int>, février 2001.
[xxii] Derek Yach et Stella Bialous, « Junking science to promote tobacco », American Journal of Public Health, vol. 91, 2001, p. 1745-1748.
[xxiii] « WHO shuts Life Sciences Industry Group out of setting health standards », loc. cit.
[xxiv] Environmental Working Group, « EPA fines Teflon maker DuPont for chemical cover-up », <www.ewg.org>, Washington, 14 décembre 2006. Voir aussi : Amy Cortese, « DuPont, now in the frying pan », The New York Times, 8 août 2004.
[xxv] Michael Jacobson, « Lifting the veil of secrecy from industry funding of nonprofit health organizations », International Journal of Occupational and Environmental Health, vol. 11, 2005, p. 349-355.
[xxvi] Diane Benford, « The acceptable daily intake, a tool for ensuring food safety », ILSI Europe Concise Monographs Series, International Life Sciences Institute, 2000.
[xxvii] Ibid. C’est moi qui souligne.
[xxviii] René Truhaut, « Principles of toxicological evaluation of food additives », Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, OMS, Genève, 4 juillet 1973. C’est moi qui souligne.
[xxix] Entretien de l’auteure avec Diane Benford, Londres, 11 janvier 2010.
[xxx] House of Representatives, Problems Plague the EPA Pesticide Registration Activities, U.S. Congress, House Report 98-1147, 1984.
[xxxi] Office of Pesticides and Toxic Substances, Summary of the IBT Review Program, EPA, Washington, juillet 1983.
[xxxii] « Data validation. Memo from K. Locke, Toxicology Branch, to R. Taylor, Registration Branch », EPA, Washington, 9 août 1978.
[xxxiii] Communications and Public Affairs, « Note to correspondents », EPA, Washington, 1er mars 1991.
[xxxiv] The New York Times, 2 mars 1991.