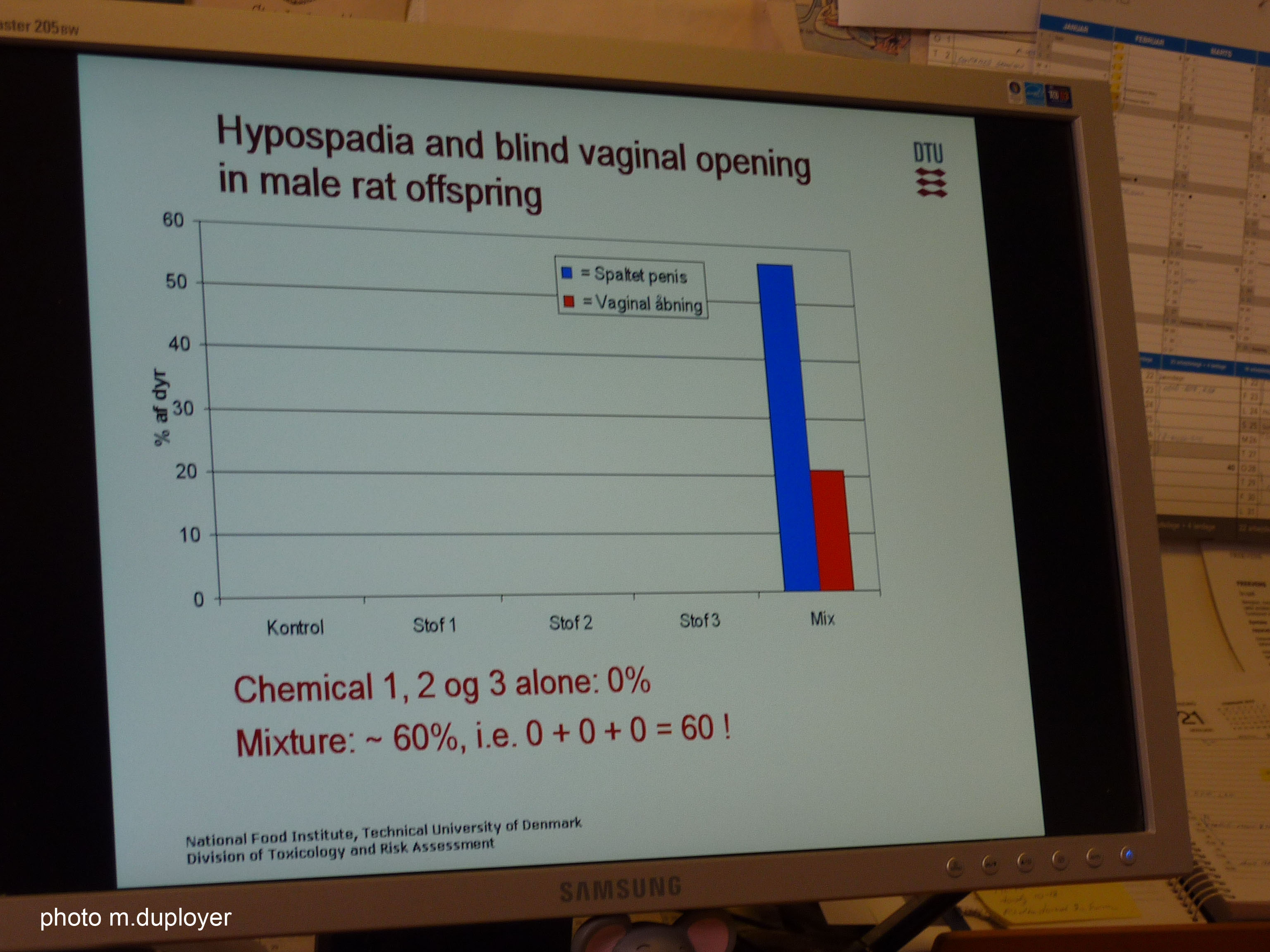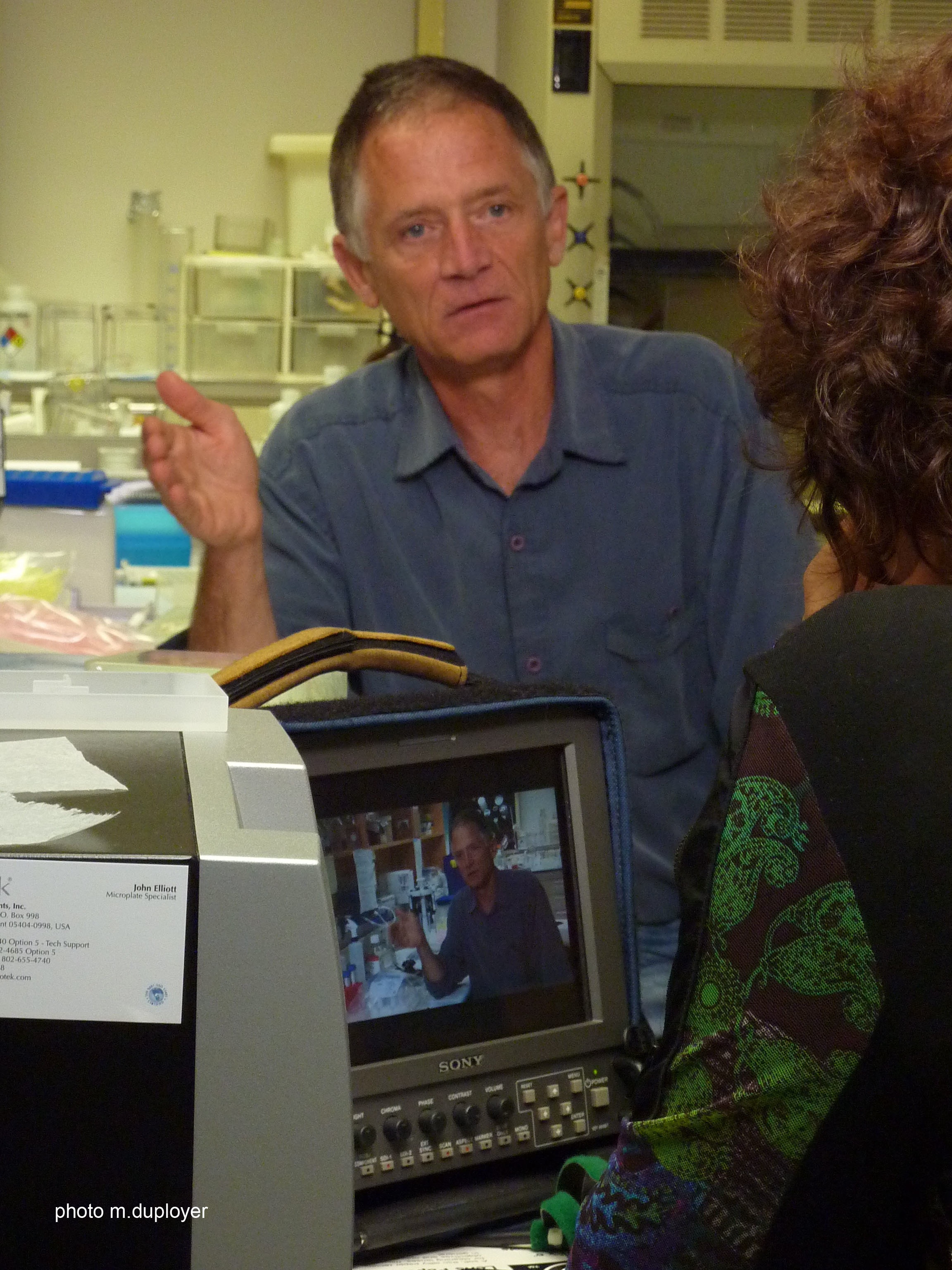Je mets en ligne la suite de mon livre Notre poison quotidien, concernant l’« affaire Richard Doll » qui anéantit à jamais la crédibilité de l’épidémiologue britannique et de sa fameuse étude sur les causes du cancer.
Richard Doll travaillait pour Monsanto
« Quand vous prépariez votre étude sur les causes du cancer, saviez-vous que Richard Doll travaillait secrètement comme consultant pour Monsanto ? » La question a fait littéralement bondir de son siège Sir Richard Peto, qui s’est mis à arpenter son bureau, avant de se rasseoir pour déclarer sur un ton presque inaudible : « Ce n’était pas un secret… Ce n’était pas un secret… Il a accepté de conseiller Monsanto et les jours où il travaillait pour la firme, il gagnait initialement 1 000 dollars par jour, puis cette somme fut portée à 1 600 dollars. En fait, il aidait l’entreprise à organiser et évaluer ses données toxicologiques pour qu’elle puisse plus facilement identifier les produits qui présentaient quelques dangers… Quand nous avons fait notre étude, le gouvernement américain nous a proposé de l’argent, mais nous n’avons pas voulu le prendre. J’ai suggéré de faire une donation à Amnesty International, mais le gouvernement a refusé en disant que c’était une association communiste. Alors, Richard Doll a décidé de donner tout l’argent qu’il gagnait au Green College d’Oxford[1]. Il n’a jamais rien gardé pour lui…
– Les enquêtes montrent que les rémunérations que Sir Doll a touchées de Monsanto, mais aussi de Dow Chemical et des industries du chlorure de vinyle ou de l’amiante n’ont jamais été rendues publiques. Quelles preuves avez-vous de ces donations ?
– À cette époque, ce n’était pas courant de déclarer ce genre de rémunérations, mais par exemple, dans le cas du tabac, il a déclaré sous serment qu’il n’avait rien touché de l’industrie du tabac. »
Et pour cause : on imagine mal en effet que les fabricants de cigarettes aient payé Richard Doll pour confirmer le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon… Dans un article de 2007 intitulé « Héros ou scélérat ? », l’historien américain Geoffrey Tweedale note à juste titre qu’il « est évidemment inconcevable que Doll ait perçu de l’argent de l’industrie du tabac, mais pourquoi a-t-il adopté une double morale en acceptant de l’argent non déclaré d’autres fabricants de produits cancérigènes[i] ».
« Le fait qu’il ait été rémunéré pour ses services a été utilisé pour salir sa légitimité, a déploré Richard Peto, qui n’avait pas l’air de mesurer l’énormité de ses propos.
– Cela se comprend, rétorquai-je, d’autant plus qu’il a été payé par Monsanto pour affirmer que la dioxine n’était pas cancérigène, ce qui s’est révélé une erreur grossière…
– Ce n’était pas une erreur. Je pense qu’il n’y a pas de preuves convaincantes que la dioxine induise des cancers chez les humains », m’a répondu Sir Peto, avec un tel aplomb que je me suis demandé s’il croyait vraiment ce qu’il disait ou si tout simplement il a préféré mentir, pour défendre l’honneur perdu de son mentor…
On se souvient en effet que la dioxine a été classée « cancérigène pour les humains » en 1994 par le CIRC. Une décision très tardive, qui s’explique précisément par l’intervention de Richard Doll dans ce dossier. Cette incroyable histoire, que j’ai déjà partiellement évoquée dans Le Monde selon Monsanto, en dit long sur l’influence que peuvent exercer quelques sommités scientifiques quand elles décident de servir les intérêts de grandes firmes, fût-ce au détriment de l’intérêt général. Tout commence en 1973, lorsqu’un jeune chercheur suédois du nom de Lennart Hardell découvre que l’exposition aux herbicides 2,4-D et 2,4,5-T, les deux composants de l’agent orange fabriqués notamment par Monsanto, provoque des cancers. En effet, il a reçu en consultation un homme de soixante-trois ans, atteint d’un cancer du foie et du pancréas, qui lui raconte que, pendant vingt ans, son travail a consisté à pulvériser un mélange des deux désherbants sur les forêts du nord de la Suède. En collaboration avec trois autres scientifiques, Lennart Hardell conduit alors une longue recherche qui sera publiée en 1979 dans The British Journal of Cancer, montrant le lien entre plusieurs cancers, dont le sarcome des tissus mous et les lymphomes hodgkiniens ou non hodgkiniens, et l’exposition à la dioxine, un polluant du 2,4,5-T[ii].
En 1984, Lennart Hardell est invité à témoigner dans le cadre d’une commission d’enquête mise en place par le gouvernement australien, dans le but de statuer sur les demandes de réparations revendiquées par les vétérans de la guerre du Viêt-nam. Un an plus tard, la commission royale sur « l’usage et les effets des produits chimiques sur le personnel australien au Viêt-nam » rend son rapport, lequel provoque une vive polémique[iii]. Dans un article publié en 1986 dans la revue Australian Society, le professeur Brian Martin, qui enseigne au Département de science et technologie à l’université de Wollongong, dénonce les manipulations qui ont conduit à ce qu’il appelle l’« acquittement de l’agent orange[iv] ».
« Aucun vétéran n’a souffert de l’exposition aux produits chimiques utilisés au Viêt-nam, conclut en effet le rapport, avec un optimisme surprenant. C’est une bonne nouvelle et la commission émet le vœu fervent qu’elle soit criée sur tous les toits ! » Dans son article, le professeur Martin raconte comment les experts cités par l’association des vétérans du Viêt-nam ont été « vivement attaqués » par l’avocat de la filiale de Monsanto en Australie. Plus grave encore : les auteurs du rapport recopièrent presque in extenso deux cents pages fournies par Monsanto pour invalider les études publiées par Lennart Hardell et son collègue Olav Axelson[v]. « L’effet de ce plagiat [a été] de présenter le point de vue de Monsanto comme étant celui de la Commission », a commenté Brian Martin. Par exemple, dans le volume capital concernant les effets cancérigènes du 2,4-D et du 2,4,5-T, « quand le texte de Monsanto dit “il est suggéré”, le rapport écrit “la commission a conclu” ; mais pour le reste, tout a été tout simplement copié. »
Très durement mis en cause par le rapport, qui insinue qu’il a manipulé les données de ses études, Lennart Hardell épluche à son tour le fameux opus. Et il découvre « avec surprise que le point de vue de la commission est soutenu par le professeur Richard Doll dans une lettre qu’il a adressée le 4 décembre 1985 à Justice Phillip Evatt, le président de la commission », ainsi qu’il l’a révélé dans un article paru au printemps 1994. « Les conclusions du docteur Hardell ne peuvent pas être soutenues et, à mon avis, son travail ne devrait plus être cité comme une preuve scientifique, tranchait l’éminent épidémiologiste britannique. Il est clair […] qu’il n’y a aucune raison de penser que le 2,4-D et le 2,4,5-T sont cancérigènes pour les animaux de laboratoire et que même la TCDD (dioxine) qui a été présentée comme un polluant dangereux contenu dans les herbicides est, au plus, faiblement cancérigène pour les animaux[vi]. »
Jusqu’à ce jour de 2006, où Lennart Hardell fait une incroyable découverte. Informé que son célèbre détracteur (décédé en 2005) a déposé ses archives personnelles dans la bibliothèque de la fondation Wellcome Trust de Londres, qui se présente comme une « fondation de bienfaisance dédiée à l’accomplissement d’améliorations extraordinaires pour la santé des hommes et des animaux », il décide de les consulter. En effet, ainsi que l’annonçait en 2002 un article de Chris Beckett, le responsable de la bibliothèque, « les papiers personnels de Sir Richard Doll ont été classés et sont disponibles. Illustrant l’engagement de toute une vie au service de la recherche épidémiologique, ils mettent en évidence un sens profond de la continuité historique et de la responsabilité publique et montrent parfaitement les liens sociaux et éthiques dans lesquels s’enracine l’épidémiologie[vii] ». Dans son éloge, le bibliothécaire de Wellcome Trust ne souffle mot de la présence dans ces archives de plusieurs documents compromettants attestant des liens financiers qui unissaient le « distingué épidémiologiste » et les fabricants de poisons, et que Hardell a découverts. Parmi eux : une lettre à en-tête de Monsanto, datée du 29 avril 1986. Rédigée par un certain William Gaffey, l’un des scientifiques de la firme qui avait signé avec le docteur Raymond Suskind plusieurs études biaisées sur la dioxine (voir supra, chapitres 8 et 9), elle confirmait le renouvellement d’un contrat financier prévoyant une rémunération de 1 500 dollars par jour. « J’apprécie grandement votre offre de prolonger mon contrat de consultant et d’en augmenter le montant », répondit Richard Doll, qui garda une copie de son courrier dans ses archives.
Ainsi, au moment où Sir Doll publiait sa célèbre étude sur les « causes du cancer », qui minimisait le rôle des polluants chimiques dans l’étiologie de la maladie, il était grassement payé par l’un « des plus grands pollueurs de l’histoire industrielle[viii] » !
L’embarras de l’establishment scientifique face aux compromissions de Doll avec l’industrie
Révélée en décembre 2006 par le quotidien britannique The Guardian, qui montra que la collaboration entre Doll et la firme de Saint Louis dura vingt ans, de 1970 à 1990[i], l’affaire fit grand bruit au pays de Sa Majesté, où elle opposa les défenseurs du scientifique anobli par la reine et ceux qui considéraient que ses conflits d’intérêts entamaient sérieusement la crédibilité de son travail. L’historien américain Geoffrey Tweedale a analysé tous les journaux qui ont alors fait leurs choux gras de l’encombrante révélation. C’est ainsi que The Observer écrivit que « Doll était un héros, pas un scélérat », qui « vivait dans une maison modeste au nord d’Oxford », en précisant que « chaque époque a ses mœurs et qu’on ne peut pas demander aux géants du passé de vivre selon les nôtres[ii] ». « En fait, souligne Geoffrey Tweedale, Doll vivait à l’une des meilleures adresses de la ville[iii]. »
L’historien américain rapporte que l’épidémiologiste reçut le soutien de tout l’establishment scientifique, qui invoquait cinq arguments : « 1) Sir Richard Doll a sauvé des millions de vie grâce à sa recherche sur le tabagisme et le cancer du poumon ; 2) à son époque, on ne déclarait pas les conflits d’intérêts ; 3) il a fait don de ses rémunérations à des œuvres de bienfaisance ; 4) il est indécent d’attaquer quelqu’un qui ne peut pas se défendre ; 5) les attaques contre sa réputation sont lancées par des “défenseurs de l’environnement” ou des personnes qui servent une cause. »
Dans une lettre adressée au Times, Richard Peto souligna avec emphase que « mondialement, le travail de Doll a probablement évité des millions de morts et qu’il va encore permettre d’en éviter des dizaines de millions[iv] ». « Personne ne le nie, rétorque Geoffrey Tweedale, mais cela n’a aucun rapport avec le débat sur les conflits d’intérêts de Doll. » Cet avis est partagé par The Sunday Mirror, qui estime que son « image strictement neutre et objective est discréditée à jamais[v] ». D’autant plus que l’épidémiologiste britannique n’hésitait pas à donner des leçons d’éthique professionnelle : « Les scientifiques qui sont tentés d’accepter un quelconque soutien de l’industrie devraient en conséquence reconnaître que leurs résultats peuvent être utilisés par l’industrie pour servir ses intérêts », déclarait-il en 1986, un an après avoir dénigré secrètement les travaux de Lennart Hardell[vi].
Bien des années plus tard, les compromissions de Sir Doll avec l’industrie chimique continuent d’embarrasser tous ceux qui se réclament de son héritage, en se référant à sa fameuse étude de 1981 sur les causes du cancer. C’est le cas par exemple des responsables de l’American Cancer Society (ACS), une institution qui constitue une référence dans le domaine de la cancérologie et dont les liens avec l’industrie pharmaceutique ont souvent été dénoncés. En octobre 2009, j’ai pu rencontrer le docteur Michael Thun, qui fut vice-président de l’ACS de 1998 à 2008, en charge de la recherche épidémiologique sur le cancer, et qui y garde un poste honorifique. Peu de temps avant ma visite dans le luxueux bâtiment de la vénérable société à Atlanta, l’épidémiologiste avait cosigné un article dans le Cancer Journal for Clinicians, où les auteurs dissertaient de manière quelque peu contradictoire sur les « facteurs environnementaux et le cancer[vii] » : « Les données expérimentales de cancérogénicité ne sont pas disponibles pour de nombreux produits industriels et commerciaux, déploraient-ils d’un côté ; et, idéalement, ces études devraient être réalisées avant que les produits soient mis sur le marché, plutôt qu’après que les humains ont été largement exposés » ; tandis que, de l’autre, ils resservaient la sempiternelle étude : « Bien que la contribution des polluants environnementaux et professionnels aux causes du cancer soit significative, celle-ci est beaucoup moins importante que l’impact du tabagisme. […] En 1981, on a estimé en effet qu’environ 4 % des morts par cancer étaient dus à des expositions professionnelles. »
« Comment pouvez-vous continuer à citer l’étude de Doll et Peto, alors qu’on sait aujourd’hui que Richard Doll était payé comme consultant par Monsanto, ai-je demandé à Michael Thun, qui ne s’attendait manifestement pas à cette question.
– Je ne pense pas que Doll ait eu besoin de cet argent pour vivre, m’a-t-il répondu, visiblement embarrassé, car il était un homme très fortuné, grâce à sa femme qui possédait une entreprise. De plus, il a toujours dit que l’argent que lui versaient les firmes chimiques servait à financer le Green College d’Oxford.
– Comment le savez-vous ?
– C’est toujours ce que j’ai entendu dire, a concédé l’épidémiologiste de l’American Cancer Society.
– Est-il courant que d’éminents scientifiques impliqués dans la santé publique travaillent aussi pour l’industrie ?
– Malheureusement, c’est très courant en médecine et cela ne devrait pas se produire, a lâché Michael Thun. Ce serait une bonne idée que les chercheurs qui étudient les médicaments ne reçoivent pas d’argent des firmes pharmaceutiques ou que ceux qui émettent leur avis sur les effets des polluants chimiques ne soient pas payés par l’industrie qui les fabrique.
– C’est pourtant ce qu’a fait Richard Doll ?
– Certes, et c’est fort regrettable[viii]. »
Un « regret » que partage Devra Davis, mais sur un mode autrement tranchant : « J’ai été vraiment très déçue d’apprendre que le grand Richard Doll, qui avait été un modèle pour toute une génération d’épidémiologistes, avait œuvré secrètement pour l’industrie chimique, m’a-t-elle affirmé. Certes, il n’était pas le seul : il y eut aussi Hans-Olav Adami, de l’Institut Karolinska à Stockholm, ou Dimitri Trichopoulos, de l’université de Harvard[1], mais le cas de Doll est particulièrement grave, car sa renommée était telle que tout le monde prenait ce qu’il disait pour parole d’Évangile. Ses expertises contribuèrent à retarder l’intérêt des politiques pour les causes environnementales des maladies chroniques, ainsi que pour la réglementation de toxiques très dangereux comme la dioxine et, surtout, le chlorure de vinyle. »
[1] Ouvert en 1979, le Green College est l’une des facultés les plus récentes de l’université d’Oxford. Fondé par Richard Doll, qui voulait développer les liens entre la médecine et le monde des affaires, il doit son nom à Cecil Green, un industriel américain, patron de Texas Instruments, qui finança sa création. En 2008, le Green College a fusionné avec le Templeton College.
[i] Geoffrey Tweedale, « Hero or Villain ? Sir Richard Doll and occupational cancer », The International Journal of Occupational and Environmental Health, vol. 13, 2007, p. 233-235.
[ii] Lennart Hardell et Anita Sandstrom, « Case-control study : soft tissue sarcomas and exposure to phenoxyacetic acids or chlorophenols », The British Journal of Cancer, vol. 39, 1979, p. 711-717 ; Mikael Eriksson, Lennart Hardell et alii, « Soft tissue sarcoma and exposure to chemical substances : a case referent study », British Journal of Industrial Medicine, vol. 38, 1981, p. 27-33 ; Lennart Hardell, Mikael Eriksson et alii, « Malignant lymphoma and exposure to chemicals, especially organic solvents, chlorophenols and phenoxy acids », British Journal of Cancer, vol. 43, 1981, p. 169-176 ; Lennart Hardell et Mikael Erikson, « The association between soft-tissue sarcomas and exposure to phenoxyacetic acids : a new case referent study », Cancer, vol. 62, 1988, p. 652-656.
[iii] Royal Commission on the Use and Effects of Chemical Agents on Australian Personnel in Viêt-nam, Final Report, vol. 1-9, Australian Government Publishing Service, Canberra, 1985.
[iv] « Agent Orange : the new controversy. Brian Martin looks at the Royal Commission that acquitted Agent Orange », Australian Society, vol. 5, n° 11, novembre 1986, p. 25-26.
[v] Monsanto Australia Ltd, « Axelson and Hardell. The odd men out. Submission to the Royal Commission on the use and effects on chemical agents on Australian personnel in Vietnam », 1985.
[vi] Cité in Lennart Hardell, Mikael Eriksson et Olav Axelson, « On the misinterpretation of epidemiological evidence, relating to dioxin-containing phenoxyacetic acids, chlorophenols and cancer effects », New Solutions, printemps 1994.
[vii] Chris Beckett, « Illustrations from the Wellcome Library. An epidemiologist at work : the personal papers of Sir Richard Doll », Medical History, vol. 46, 2002, p. 403-421.
[viii] Marie-Monique Robin, Le Monde selon Monsanto, op. cit., p. xxx.
[1] Hans-Olav Adami a été recruté par le fameux Dennis Paustenbach d’Exponent (voir supra, chapitre 9) pour minimiser la toxicité de la dioxine, au moment où l’Agence de protection de l’environnement revoyait sa réglementation (voir Lennart Hardell, Martin Walker et alii, « Secret ties to industry and conflicting interests in cancer research », American Journal of Industrial Medicine, 13 novembre 2006).
[i] Sarah Boseley, « Renowned cancer scientist was paid by chemical firm for 20 years », The Guardian, 8 décembre 2006.
[ii] Cristina Odone, « Richard Doll was a hero, not a villain », The Observer, 10 décembre 2006.
[iii] Geoffrey Tweedale, « Hero or Villain ? », loc. cit.
[iv] Richard Peto, The Times, 9 décembre 2006.
[v] Richard Stott, « Cloud over Sir Richard », The Sunday Mirror, 10 décembre 2006.
[vi] Julian Peto et Richard Doll, « Passive smoking », British Journal of Cancer, vol. 54, 1986, p. 381-383. Julian Peto est le frère de Richard Peto.
[vii] Elizabeth Fontham, Michael J. Thun et alii, on behalf of ACS Cancer and the Environment Subcommittee, « American Cancer Society perspectives on environmental factors and cancer », Cancer Journal for Clinicians, vol. 59, 2009, p. 343-351.
[viii] Entretien de l’auteure avec Michael Thun, Atlanta, 25 octobre 2009.
Photos:
– Richard Peto
– Devra Davis
-Michael Thun