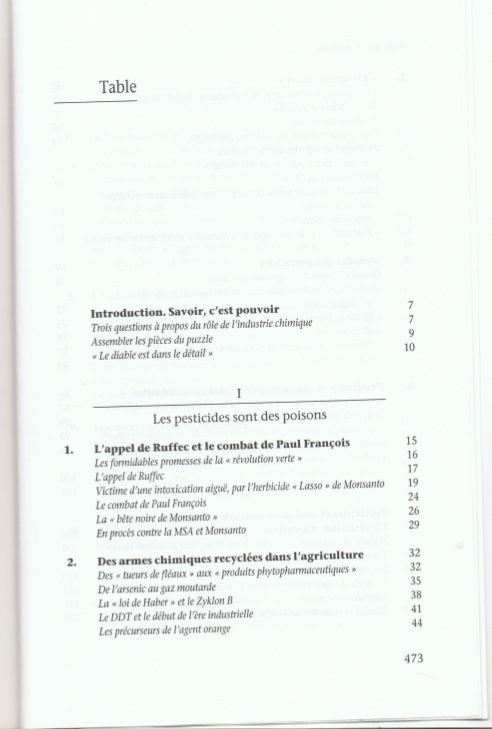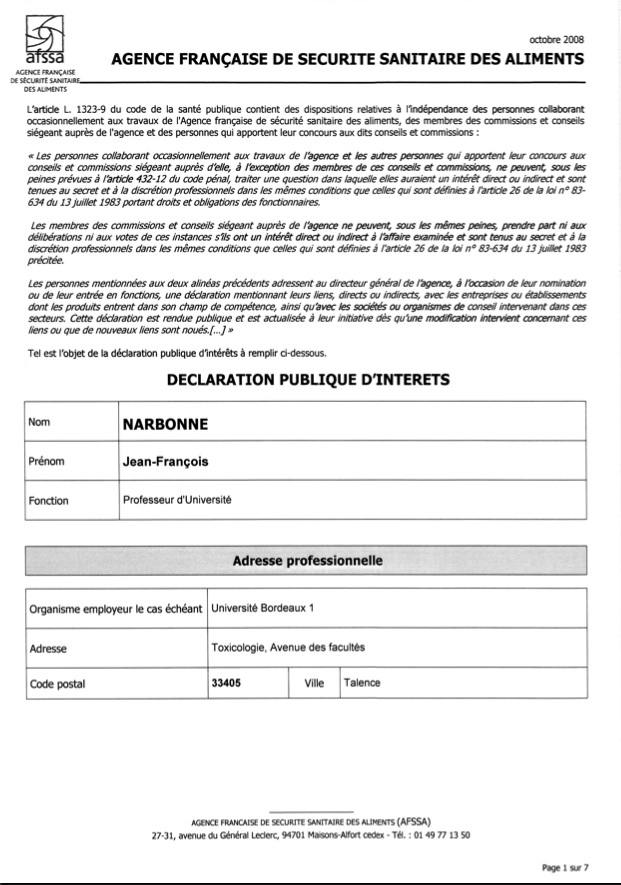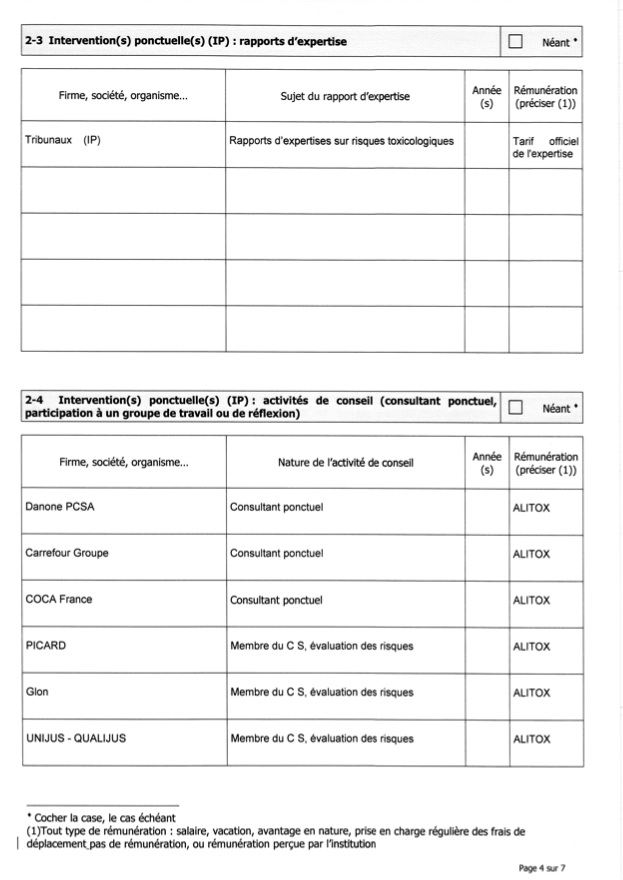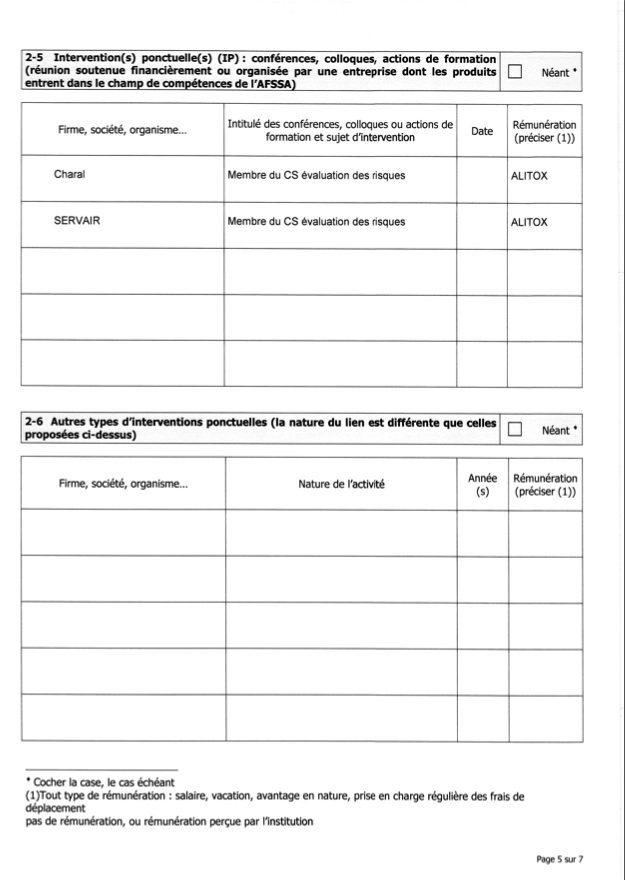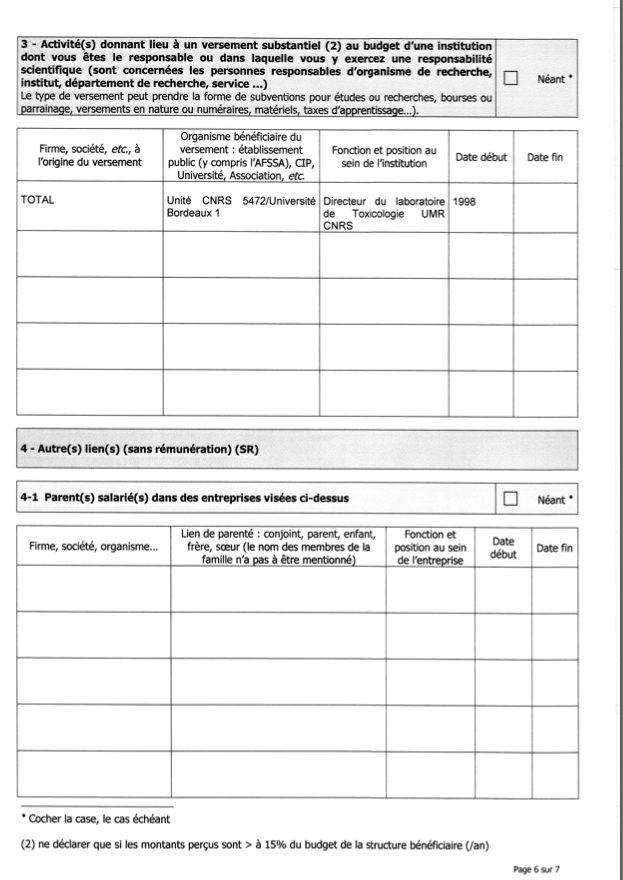Je poursuis la transcription d’extraits de mon livre Notre poison quotidien et notamment du chapitre 16 que je consacre aux perturbateurs endocriniens. Dans mon commentaire précédent, je racontais ma rencontre avec Theo Colborn, une zoologue américaine, qui a découvert l’activité funeste des perturbateurs endocriniens. Elle est l’auteur d’un livre Our Stolen Future, publié en 1996 ( et traduit en français:L’homme en voie de disparition?) qui fit l’effet d’une bombe car c’était la première fois qu’un(e) scientifique révélait les effets des hormones de synthèse utilisés massivement dans l’industrie pour des raisons diverses et variées – par exemple rigidifier (Bisphénol A) ou au contraire rendre mou le plastique (phtalates)- sur la faune et les humains.
Aux Etats Unis l’émotion fut telle que le Congrès vota une loi exigeant de l’Agence de Protection de l’Environnement (EPA) qu’elle mette sur pied un programme capable de tester rigoureusement les substances chimiques susceptibles d’être des perturbateurs endocriniens. Malheureusement, comme je le raconte dans mon livre, ce programme a été enterré avec l’arrivée de Georges Bush à la Maison Blanche. L’administration Obama vient de demander sa réactivation.
Théo Colborn dirge, aujourd’hui, un centre d’information sur les perturbateurs endocriniens où elle s’intéresse tout particulièrement aux effets de ces poisons chimiques sur les enfants exposés in utero. De nombreuses études ont , en effet, établi un lien entre l’exposition foetale à de faibles doses de perturbateurs endocriniens et les troubles du comportement de l’enfant (comme l’hyperactivité), la baisse des capacités cognitives (Quotient intellectuel réduit) mais aussi l’autisme.Au moment où j’écris ces lignes, j’apprends dans Le Monde du 23 avril 2011 que l' »exposition prénatale aux pesticides fait baisser le QI » d’après trois études publiées dans le journal Environmental Health Perspectives:
Deux études menées à New York et une étude menée dans une communauté agricole de Californie révèlent qu’un fœtus exposé aux pesticides pendant son développement peut avoir un quotient intellectuel sensiblement moins élevé.
L’étude menée en Californie par l’université Berkeley a établi qu’un enfant de 7 ans, qui a été 10 fois plus exposé aux pesticides organophosphorés (très utilisés dans l’agriculture), possède un QI inférieur de 5,5 points en comparaison avec des enfants du même âge non exposés. Pour obtenir ces résultats, l’université de Berkeley et le Centre médical Mount Sinaï de New York, ont analysé les résidus de pesticides dans l’urine maternelle, et l’université de Columbia, à New-York, a testé le niveau de chlorpyrifos dans les cordons ombilicaux. Le chlorpyrifos est un pesticide organophosphoré dont la toxicité pour le cerveau a été démontrée.
En France, l’étude Elfe lancée sur 20.000 enfants prendra en compte le contact des enfants avec les pesticides. Chaque année, 65.000 tonnes de pesticides sont rejetés dans notre environnement et 90% des Français en seraient imprégnés.Source: Le monde.fr et Terra Femina
Dans mon enquête, je me suis particulièrement attachée au chlorpyrifos , un insecticide fabriqué par Dow AgroSciences, largement utilisé dans le monde et suspecté d’être un perturbateur endocrinien.
Pour plus d’informations sur les perturbateurs endocriniens, j’invite les internautes anglophones à consulter le site de Théo Colborn:
http://www.endocrinedisruption.com/home.php
Parmi les perturbateurs endocriniens, il y a les fameux PCB de Monsnato… Voici la suite de ce que j’écris dans mon livre:
Les PCB sont partout
J’ai déjà présenté brièvement les polluants organiques persistants, les fameux « POP » (voir supra, chapitre 2) qui sont bannis par la convention de Stockholm de 2001. Parmi ceux que l’on surnomme la « sale douzaine », il y a le DDT, l’« herbicide miracle » de l’après-guerre, la dioxine, mais aussi les PCB, auxquels j’ai consacré un chapitre dans mon livre Le Monde selon Monsanto. J’y racontais comment la firme de Saint Louis avait caché pendant cinq décennies la haute toxicité de cette molécule chlorée qui présente une stabilité thermique et une résistance au feu remarquables, et fut utilisée comme liquide réfrigérant dans les transformateurs électriques et les appareils hydrauliques industriels, mais aussi comme lubrifiant dans des applications aussi variées que les plastiques, les peintures, l’encre ou le papier. « Les PCB sont partout », écrivais-je alors et c’est en lisant Our Stolen Future que j’ai véritablement compris comment ils avaient pu coloniser la planète et menacer la survie de nombreuses espèces animales, y compris l’espèce humaine.
Dans son livre, Theo Colborn imagine le voyage d’une molécule de polychlorobiphényle (PCB), fabriquée au printemps 1947 dans l’usine de Monsanto à Anniston. Baptisé « Arochlor 1254 », le PCB est chargé dans un train qui le transporte vers une usine de transformateurs électriques de General Electric à Pittsfield, dans le Massachusetts. Mélangé à une huile – pour former du « pyralor » (États-Unis) ou du « pyralène (France) –, il remplit un transformateur électrique, installé dans une raffinerie de pétrole au Texas. En juillet 1947, un violent orage fait griller l’installation électrique et le transformateur est abandonné dans une décharge publique, après qu’un ouvrier consciencieux eut déversé son contenu liquide sur le parking de la raffinerie où le PCB a imbibé les poussières rouges du sol[1]. Quatre mois plus tard, un vent puissant soulève les poussières du parking et le PCB entame un long périple qui le conduira… jusqu’à l’Arctique. En effet, exposée à la chaleur du soleil, la molécule se met à flotter comme une vapeur qui peut monter très haut et se déplacer au gré des vents sur de grandes distances. Dès qu’elle croise de l’air froid, elle retombe brutalement au petit bonheur la chance : sur l’herbe d’un champ, broutée par les vaches, où elle s’incrustera dans la graisse du lait, car elle est très lipophile ; elle peut aussi atterrir sur la surface d’un lac où elle s’accrochera à une algue, avant d’être happée par une mouche aquatique, dévorée ensuite par un crustacé, qui sera mangé par une truite, laquelle finira dans l’assiette d’un pêcheur du dimanche.
À noter qu’à la fin de sa courte vie de dix jours, la concentration de PCB dans la mouche aquatique est quatre cents fois plus élevée que celle de l’eau, car la molécule de Monsanto n’est pas biodégradable et a la faculté de s’accumuler dans les tissus adipeux (et en bout de course dans nos graisses à nous, les consommateurs). Si le pêcheur a raté sa prise, la truite blessée finit dans le bec d’une mouette (dont la concentration en PCB est 25 millions de fois supérieure à celle de l’eau du lac), qui s’envole vers le lac d’Ontario pour convoler. Elle y pond deux œufs. L’un éclot six semaines plus tard, mais l’oisillon est mort, car le PCB (comme le DDT ou la dioxine) a pénétré le jaune de l’œuf et tué l’embryon. L’autre œuf ne donne rien, mais il est repéré par une mouette qui le casse ; le jaune tombe dans le lac et est happé par une écrevisse, mangée par une anguille, qui remonte vers l’océan Atlantique, pour frayer, pondre et mourir. Sa carcasse se désintègre dans les eaux chaudes tropicales des Bahamas et, libéré, le PCB reprend son voyage aérien, poussé pour les vents, toujours plus vers le nord. L’incroyable cycle de la vie lui fera terminer sa course dans la graisse d’un ours polaire, dont la concentration en PCB est 3 milliards de fois supérieure à celle de son milieu environnant, car il est le « prédateur suprême et le plus grand carnivore de la région ».
Or, souligne Theo Colborn dans Our Stolen Future, « à l’instar des ours polaires, les hommes partagent les risques de se nourrir en haut de la chaîne alimentaire. Les produits chimiques synthétiques persistants qui ont envahi l’univers du grand ours ont également envahi le nôtre[i] ». Et de conclure : « C’est ainsi que, un demi-siècle plus tard, la molécule fabriquée un jour de printemps peut se retrouver absolument n’importe où : dans le sperme d’un homme infertile testé dans une clinique dans le nord de l’État de New York, dans le caviar le plus fin ou les tissus adipeux d’un nouveau-né du Michigan, dans les pingouins de l’Antarctique, le thon d’un sushi servi dans un bar de Tokyo ou les pluies de la mousson tombant sur Calcutta, dans le lait d’une mère allaitant son bébé en France ou dans la jolie perche à rayures pêchée lors d’un week-end estival[ii]. »
« Alors que je reconstituais les effets sur la faune des PCB et autres POP, je découvrais aussi les premières études réalisées sur des humains fortement exposés, m’a expliqué l’experte en santé environnementale. Elles montraient que les enfants inuits présentaient un taux de PCB sept fois supérieur à celui des enfants du Sud du Canada ou des États-Unis et que le lait maternel était hautement contaminé[iii]. Elles montraient aussi que ces enfants souffraient de déficiences immunitaires, comme les bélugas de la baie du Saint-Laurent, conduisant à des otites chroniques ou à une production affaiblie d’anticorps lors des vaccinations. Une autre étude réalisée auprès de mères ayant consommé des poissons du lac Michigan révélait que les enfants exposés in utero aux PCB souffraient de troubles neurologiques ou de déficiences motrices[iv]. Dix ans plus tard, les chercheurs ont constaté que ces mêmes enfants avaient des problèmes auditifs et visuels, ainsi qu’un quotient intellectuel inférieur de 6,2 points par rapport à la moyenne de leur âge[v].
« Aujourd’hui, tout cela a été largement confirmé, mais à l’époque c’était nouveau. Et pour comprendre ce qui se passait, j’ai réalisé d’immenses tableaux avec, d’un côté, les espèces animales ou humaine concernées et, de l’autre, les troubles observés. Finalement, après des semaines à tourner en rond dans mon bureau, j’ai compris le lien qu’avaient toutes ces histoires : c’était le système endocrinien des organismes vivants qui était affecté dès la vie intra-utérine, ce qui entraînait des malformations congénitales, des troubles de la reproduction, des désordres neurologiques et un affaiblissement du système immunitaire chez les descendants. Voilà comment j’ai proposé d’organiser une rencontre entre tous les chercheurs qui avaient été confrontés à ce genre de problèmes. Et ce fut un moment inoubliable[vi]. »
Juillet 1991 : la déclaration historique de Wingspread
Sans doute aucun, la « rencontre » restera marquée d’une croix dans l’histoire médicale, même si, aujourd’hui, nombre de sommités de la médecine officielle n’en ont jamais entendu parler ou du moins le prétendent. Mais pour les vingt et un pionniers qui se réunirent, du 26 au 28 juillet 1991, dans le centre de conférences de Wingspread (Wisconsin), ce fut une « expérience fondamentale », selon les mots d’Ana Soto, l’une des participantes. Pour organiser ce meeting inédit, Theo Colborn avait sollicité l’aide de John Peterson Myers – dit « Pete Myers » –, un jeune biologiste qui avait travaillé sur le déclin des populations d’oiseaux marins migrant de l’Arctique à l’Amérique du Sud et qui cosignera Our Stolen Future. Intitulé « Les altérations du développement sexuel induites par la chimie : la connexion faune/humains », le colloque a permis de confronter les travaux de scientifiques venus de quinze disciplines, dont l’anthropologie, l’écologie, l’endocrinologie, l’histopathologie, l’immunologie, la psychiatrie, la toxicologie, la zoologie et même le droit.
« Cette rencontre a constitué un tournant dans ma carrière, m’a raconté Louis Guillette, un zoologue de l’université de Floride que j’ai rencontré le 22 octobre 2009, lors d’un colloque à la Nouvelle-Orléans. En effet, je me débattais tout seul dans mon coin pour essayer de décrypter les troubles que je constatais sur les alligators de Floride et, tout d’un coup, tout s’est éclairé, grâce à ce formidable échange interdisciplinaire et à l’énorme travail de Theo. » Et le scientifique de me raconter son histoire : en 1988, le gouvernement de Floride lui demande de récolter des œufs d’alligators dans le but de créer des fermes d’élevage. Il ratisse une dizaine de lacs de l’État d’où il rapporte plus de 50 000 œufs. Il les met en couveuse et constate que seuls 20 % des œufs prélevés dans l’immense lac d’Apopka (12 500 hectares, situés non loin d’Orlando et de Disney World) ont éclos, contre 70 % pour les œufs issus des autres lacs. De plus, 50 % des bébés alligators sont morts dans les jours qui ont suivi leur naissance.
« Je me suis souvenu que, quelques années plus tôt, le lac avait été fortement contaminé par le déversement accidentel de dicofol, un insecticide proche du DDT, a précisé Louis Guillette. Curieusement, on ne trouvait plus de trace du pesticide dans les eaux du lac, mais tout indiquait qu’il était stocké dans les sédiments, la faune aquatique et la graisse des crocodiles. Quand j’ai commencé à étudier la population des alligators, je m’attendais à trouver des cancers, mais ce que j’ai observé n’avait rien à voir avec des tumeurs : les femelles présentaient des malformations des ovaires et des niveaux anormalement élevés d’œstrogène ; quant aux mâles, ils avaient souvent des micro-pénis et des taux de testostérone extrêmement bas. La seule hypothèse qui me paraissait plausible, bien qu’elle fût difficile à expliquer, c’est que ces malformations étaient dues à un dérèglement survenu pendant la formation de l’embryon, car les œufs étaient contaminés par des résidus de pesticides.
– Est-ce que vous aviez déjà vu des anormalités similaires ?
– Jamais !, m’a répondu sans hésiter le spécialiste des sauriens. À l’époque, la littérature scientifique était complètement muette sur ce genre de malformations, qui n’avaient jamais été rapportées chez les alligators ni chez aucune autre espèce sauvage. En revanche, j’avais lu des études sur des animaux expérimentaux exposés in utero au distilbène, le médicament prescrit aux femmes enceintes pendant les années 1950 et 1960 [voir infra, chapitre 17]. Elles faisaient état de malformations des ovaires ou du pénis. Mais cela ne faisait que renforcer mon trouble, car je me disais : ces alligators n’ont pas reçu de médicaments, ni été exposés volontairement à une forte dose d’une molécule de synthèse, alors comment se fait-il que les faibles doses de pesticide présentes dans leurs organismes provoquent de tels effets ?
– Quelles étaient les doses de pesticides que vous avez mesurées ?
– Elles étaient de l’ordre de 1 ppm, c’est-à-dire des doses que l’on considère généralement comme biologiquement inactives et que l’on trouve tous les jours dans notre environnement ou nos aliments…
– En quoi cette expérience avec les alligators peut-elle être utile aux humains ?
– Il faut bien comprendre que la faune constitue une sentinelle pour la santé humaine, m’a répondu Louis Guillette. Les animaux sauvages nous alertent sur les dangers environnementaux qui nous menacent et spécialement nos enfants. Tous les mammifères, qu’ils soient humains ou sauriens, partagent les mêmes hormones, la même structure des ovaires ou des testicules. D’ailleurs, ce que j’ai constaté dans les années 1980 et 1990 sur les crocodiles se voit aujourd’hui chez de nombreux enfants un peu partout dans le monde.
– Notamment chez les fils de paysans ?
– Exact. Il y a des études qui montrent que les fils d’agriculteurs qui utilisent des pesticides ont un taux plus élevé de micro-pénis ou d’anomalies des testicules.
– Est-ce qu’aujourd’hui le lac Apopka a été nettoyé ?
– Il est en cours de restauration. Les autorités essaient d’extraire les pesticides, qui sont nombreux, mais malheureusement ce n’est pas facile, car certains d’entre eux, comme le dicofol ou le DDT, se sont fixés dans la chaîne alimentaire du lac. Ils sont enfermés dans les graisses des organismes vivants et nous n’en viendrons à bout que dans plusieurs générations.
– Et est-ce que les alligators sont guéris ?
– Non ! Les femelles sont comme nous, elles se reproduisent sur plusieurs décennies et nous continuons d’observer les mêmes dysfonctionnements qu’il y a vingt ans.
– En quoi la conférence de Wingspread vous a-t-elle éclairé ?
– Grâce à l’échange avec mes collègues, qui avaient fait des constats similaires sur d’autres espèces sauvages, j’ai compris que certains produits chimiques se comportaient comme des hormones et ce fut une vraie révélation », conclut Louis Guillette[vii].
Au terme de la conférence, les participants ont signé un manifeste, baptisé « Déclaration de Wingspread », où, dès 1991, ils attiraient l’attention sur les méfaits causés par des molécules, qui, vingt ans plus tard, continuent d’être ignorés par les pouvoirs publics : « De nombreux composés chimiques introduits dans l’environnement par l’activité humaine sont capables de perturber le système endocrinien des animaux, y compris des poissons, de la faune et des humains. Les conséquences de cette perturbation peuvent être profondes en raison du rôle crucial joué par les hormones dans le contrôle du développement, écrivaient-ils. De nombreuses espèces sauvages sont déjà affectées par ces substances. […] Les types d’effets varient selon les espèces et les produits chimiques, mais quatre points communs peuvent être cependant soulignés : 1) les molécules peuvent avoir des effets totalement différents sur l’embryon, le fœtus ou l’organisme périnatal et sur les adultes ; 2) les effets s’expriment plus souvent chez les descendants que sur les parents exposés ; 3) le moment de l’exposition de l’organisme en développement est crucial pour déterminer son caractère et son potentiel futur ; 4) bien que l’exposition critique ait lieu pendant le développement embryonnaire, il est possible que ses signes manifestes ne s’expriment pas avant l’âge adulte. »
Enfin, les auteurs tiraient la sonnette d’alarme : « Si l’on n’élimine pas les perturbateurs synthétiques hormonaux de l’environnement, on peut s’attendre à des dysfonctionnements de grande envergure à l’échelle de la population générale. L’étendue du risque potentiel pour la faune et les humains est grande, en raison de la probabilité d’une exposition répétée et constante à de nombreux produits chimiques synthétiques connus pour être des perturbateurs endocriniens. »
[1] Combien de transformateurs ont-ils ainsi été vidés dans des décharges publiques ou dans des lieux à ciel ouvert, partout dans le monde ? Rappelons qu’en France, 545 610 appareils (dont 450 000 appartenant à EDF) contenant plus de cinq litres de PCB étaient inventoriés à la date du 30 juin 2002, cinq ans après l’interdiction de ces produits, représentant 33 462 tonnes de PCB à éliminer.
[i] Ibid., p. 106.[ii] Ibid., p. 91.
[iii] Eric Dewailly et alii, « High levels of PCBs in breast milk of Inuit women from arctic Quebec », Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, vol. 43, n° 5, novembre 1989, p. 641-646.
[iv] Joseph Jacobson et alii, « Prenatal exposure to an environmental toxin : a test of the multiple effects model », Developmental Psychology, vol. 20, n° 4, juillet 1984, p. 523-532.
[v] Joseph Jacobson et Sandra Jacobson, « Intellectual impairment in children exposed to polychlorinated biphenyls in utero », New England Journal of Medicine, vol. 335, 12 septembre 1996, p. 783-789.
[vi] Entretien de l’auteur avec Theo Colborn, Paonia, 10 décembre 2009.
[vii] Parmi les nombreuses études publiées par Louis Guillette, je recommande celle-ci : Louis Guillette et alii, « Developmental abnormalities of the gonad and abnormal sex hormone concentrations in juvenile alligators from contaminated and control lakes in Florida », Environmental Health Perspectives, vol. 102, n° 8, août 1994, p. 680-688.
La suite bientôt!
Photo (Marc Duployer): ma rencontre avec Louis Guillette, lors du colloque sur les perturbateurs endocriniens qui s’est tenu en octobre 2009 à La Nouvelle Orléans.